
Pourquoi le double Système d'évaluations SEVVE n'est-il comparable avec aucune autre démarche ?
Et supérieur à l’ensemble des labels existants dans le milieu du tourisme ?
Tout en étant accessible aux structures sans moyens, et basé sur une approche territoriale avec des évaluateurs devant se rendre in-situ.
1 – Il a été créé de manière collaborative et participative par les pionniers, les véritables spécialistes et des scientifiques, liés au secteur du tourisme responsable, dont voici les curriculums vitae sous forme réduite.
- Alain Laurent, auteur de « Tourisme responsable, clé d'entrée du développement territorial durable - Guide pour la réflexion et l'action ». Document utilisé par le MAE et l’OMT.
Président-fondateur de l’Association Territoires Responsables (disparue).
Membre d’honneur de l’ANEST.
- Pascal LLuch (Décédé dans l’exercice de son métier) : Voyageur et accompagnateur en montagne depuis les années 80, il a organisé des voyages à pied dans le monde entier, en particulier en Asie et au Sahara, où il fut pionnier sur de nombreux terrains, naturaliste spécialiste de certaines espèces.
De 2001 à 2010, il fut co-repreneur de l'agence Hommes et Montagnes créée en 1969 par Odette et Jean-Louis Bernezat (disparue).
Il a créé en 2009 le concept RandoPays®, une gamme de séjours à mobilité douce (disparu).
Et participé à l’organisation de l’écotourisme dans le Trièves.
Il était vice-président de V.V.E et co-organisateur des deux FNTR.
- Sylvain Salamero, Docteur en Géographie, spécialisé écotourisme, auteur d’une thèse au Quebec., par ailleurs accompagnateur en montagne, guide équestre, éleveur de chevaux Mérens, gérant du Centre équestre de Soularac et Président de l’Office de Tourisme des Pyrénées Cathares.
- Jean-Pierre Lamic accompagnateur (depuis 1982), en montagne, de trekking, et de raquettes , moniteur de ski, guide culturel (1988 -1995), gérant d’une maison d’hôte et de Vanoise écotourisme, Président-fondateur de l’Association des Voyageurs et Voyagistes Éco-responsables (V.V.E) et de l’Association Nationale de l’Écotourisme et du Slow-Tourisme (ANEST), organisateur de Sol &Ecotourismo et des Forums Nationaux du Tourisme Responsable, Auteur, gérant de Kalo Taxidi (édition), rédacteur d’une étude pour la Revue Espaces, Directeur de publication du Media du voyage durable, co-fondateur de la notion de compensation territoriale©.

Personnes ressources consultées et / ou invitées aux FNTR, associées aux diverses réflexions relatives à la création des critères :
- Franck Michel : Anthropologue, Auteur et chercheur indépendant, co-fondateur de La croisée des routes et responsable de l'association Déroutes & Détours. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages.
Il est Membre d’honneur de l’ANEST.
En tant que Responsable du secteur Tourisme des Éditions L’Harmattan, il a encouragé la publication de « Tourisme durable, utopie ou réalité », en avril 2008.
Ses études et écrits ont fortement inspiré les critères liés au pilier social du système.
- Augustin Fragnère : Il travaille au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne. Docteur en sciences de l'environnement et philosophe, il a mené des recherches sur les enjeux éthiques et politiques des problèmes environnementaux globaux.
Auteur de « La compensation carbone : illusion ou solution ?», éditions PUF, novembre 2009
Il est la référence scientifique du système et de V.V.E en matière de compensation carbone.
Invité au FNTR 2010.
- Vincent Vlès : Chercheur, Professeur émérite des universités, Université de Toulouse/CNRS UMR 5044.
Spécialiste des stations de montagne, de la régulation des flux de visiteurs & protection des écosystèmes.
Il est le référent concernant les questions relatives à la montagne et aux sports d’hiver.
Invité au FNTR 2010, en lien depuis.
- Sylvie Blangy : Ingénieur de recherche CNRS. Sujets de recherche : Interaction hommes-milieux, Arctique, recherche collaborative, recherche action participative, recherche autochtone, impacts miniers, adaptation aux changements globaux, écotourisme, tourisme durable.
Elle est la référence en matière d’écotourisme au sens large au sein du système SEVVE, et pour l’ANEST.
Invitée au FNTR 2012

Beaucoup d’autres spécialistes, universitaires et scientifiques ont nourri les choix effectués pour établir les critères lors de la conception de ce système.
La liste exhaustive de ces derniers, figure dans les liens menant vers les deux FNTR.
Cette démarche a été déclarée par Ecocert en 2010 comme étant certifiable par une tierce partie (eux-mêmes), et c’était l’unique parmi les 12 certifications – démarches présentées, (dont celle de V.V.E – TER_RES) évaluées par eux.
Ecocert nous a adressé ensuite ce message :
« Il est essentiel que vous définissiez clairement le type d'évaluation que vous souhaitez obtenir :
Une certification produit, qui demande des résultats précis au niveau du produit (ici le voyage ?) ou une certification processus qui certifierait un système de management opérateur du tourisme responsable dans ses pratiques ».
D’un commun accord les spécialistes cités ci-dessus ont décidé qu’un label ou une certification, ne pouvait s’adresser qu’à un produit – une offre, et en aucun cas concerner un opérateur de tourisme, et encore moins un groupement d’opérateurs...
Par conséquent, depuis 2010, l'Association des Voyageurs et Voyagistes Écoresponsables, et depuis sa création l'Association Nationale de l'Écotourisme et du Slow-Tourisme (ANEST), récusent les labels de type Agir pour le Tourisme responsable (ATR), ou Travelife.
Et par conséquent le principe même de la "Certification processus" dans le domaine du tourisme.
Position non dogmatique, mais d’ordre scientifique…
2 – Il a intégré les critères d’une dizaine de labels-certifications - démarches existant antérieurement, dont ceux du GSTC (Global Sustainable Tourism Council), dont certains se contentent.
Il a été tout d’abord créé un tableau intégrant les différentes composantes à prendre en compte.
Dans ce tableau, après avoir intégré les critères du GSTC, y avoir agrégé ceux du premier label d’ATR (2008-2014), des chartes de l’ATES, et de V.V.E, il restait plusieurs aspects non traités, identifiés comme des "manques".
Par exemple :
Social :
- La transparence des prix et la répartition de la manne touristique
- Produits externalisés : Quels sont-ils ? quelle est la prise en compte de la problématique du tourisme responsable par les entreprises sous-traitantes ?
- Partenaires ? Qui sont-ils ? Quelle est la taille de leurs structures d’accueils ?
- Le niveau de dépendance des personnes et des communautés locales vis-à-vis de l'activté touristique.
- Définition de la taille maximale des groupes en fonction des lieux ? Taille maxi des hébergements ?
- Quelle interface, quel médiateur, quel encadrement, qui est le guide ? Est-il légal et diplômé ?
- Que fait-on en cas de crise géopolitique majeure dans le pays ? Question de la création d’un fonds de solidarité.
- Créer l’obligation pour les vendeurs de lits ou places vides de mentionner qu’il s’agit d’invendus dont les prix ne peuvent en aucun cas être comparés à la valeur réelle des prestations offertes.
Gouvernance :
Est-elle adaptée ?
Si oui, expliquer pourquoi, et par quel(s) procédé(s).
Environnement :
- La prise en compte des capacités de charge - Des structures, des transports, des sites, etc.
Par exemple, quelle est la capacité de charge maximale acceptable dans un désert, un Parc National etc.
- Quel transport achemine le touriste ? - Certaines pratiques peuvent être explicitement citées comme anti durable : le 4x4, le quad, le scooter des neiges, le jet ski… Lorsqu’ils sont utilisés en tant que loisirs motorisés, et pas en tant que moyen de transport pour acheminer un groupe ou du matériel d’un point A à un point B dans un milieu qui rend leur utilisation nécessaire.
- Quel ratio : durée du voyage / distance domicile – lieu de séjour ?
- Comment générer les bénéfices nécessaires à l’entretien du territoire, la sauvegarde de la biodiversité et des paysages ?
- Quelles émissions de GES induites ? Quelles sont les mesures prises pour les réduire ?
- Entretien du territoire : Quelles retombées locales pour aider à l’entretien des chemins, murets, drainages ? Quels moyens de financement peuvent-ils provenir des retombées du tourisme (taxes sur l’utilisation des territoires).
Critères :
Qui vérifie leur pertinence, leur mise en œuvre ? Comment s’organisent les contrôles ou évaluations ?
Comment lutter contre le marketing abusif et les auto-déclarations d’appartenance au tourisme responsable ?

Dans ce tableau, ont été ensuite insérés quatre labels relatifs à l’hébergement.
Cette démarche a également révélé de nombreux manques ; social (employés, saisonniers), environnemental (pas d’ancrage territorial), voire dans l’éco-construction et les énergies utilisées.
En dernier lieu, il a été ajouté un label conçu par la MITRA (Mission d'ingénierie touristique Rhône-Alpes), beaucoup plus complet que certains conçus au niveau national, mais abandonné suite au départ de son concepteur…
En confrontant les critères de l'ensemble de ces démarches et à partir des manques identifiés, le travail a consisté à remplir les cases vides, en y insérant des critères issus de ces constatations.
C'est ainsi qu'à été élaboré un double système d'évaluation, pas encore nommé SEVVE.
Ce double système est le seul qui provient d’une démarche
- Collaborative et participative opérée par des spécialistes et scientifiques reconnus
- Non conçue pour labelliser des produits ou séjours d’une structure en particulier (pas même V.V.E qui a toujours fonctionné avec sa charte très stricte)
- Non créée dans le but d’écarter la concurrence
- Conçue réellement à l’intention du grand public
- Disposant d’une portée universelle (Séjours, produits touristiques, hébergements, territoires en tant qu’entité, acteurs, etc.)
- Non reliée à un business
- Portant en elle la notion d’intérêt général.

3 – La période intermédiaire (2012 – 2016).
Faute de moyens, et après avoir rejeté les propositions d’Ecocert qui s’apparentaient à de l’appropriation de savoir-faire, ce travail est resté en dormance jusqu’à 2016.
Entre temps, avec le collectif COPRELS (Collectif Pour Un Encadrement Légal et Sécurisé), les membres de V.V.E ont mis la pression à l’AFNOR par rapport à l’un des critères d’ATR qu'ils jugeaient illégal, et obtenu gain de cause, juste avant le décès d’un participant à un trekking encadré par un guide non qualifié.
Ce que permettait ladite certification… D’un tourisme dit « responsable » depuis 2008.
Le critère concernant les guides et la médiation en général est essentiel.
Voici ce qu’affirmait le dirigeant du groupe incluant le voyagiste lié à cet accident, avant celui-ci :
« Les guides locaux sont devenus dans la plupart des cas aussi bons que les guides français. - pire, ils sont parfois arrogants, si sûr de leur savoir-faire.
En ce qui me concerne, moi qui adore faire des trekkings, je préfère payer plus cher un voyage avec un guide local qui va m'apprendre sa vie quotidienne dans un pays que de le faire avec un guide français... ».
Déclaration qui supposerait qu’un guide n’a pas besoin d’être formé aux premiers secours pour un circuit en montagne, ni d'être diplômé, selon les adeptes de cette théorie, ce qui se trouve être en totale contradiction avec les obligations légales des opérateurs de voyages (Responsabilité de plein droit).
C’est irresponsable et la France laisse faire depuis 1997.
Le Texte fondateur du Collectif Coprels reprennait les assertions des dirigeants des agences de trekking fondateurs d’ATR, allant toutes dans le même sens… Y compris celle de celui qui fut président de ladite association de 2006 à 2013, qui, le premier, s’exonéra de ces obligations légales en 1997 ; personnes qui proposèrent l’introduction d’un critère autorisant et justifiant la présence de guides non diplômés sur des territoires nécessitant la présence d’un encadrant qui aurait dû l’être ...
Le tout à des fins uniquement lucratives, au sein d'une association régie par la Loi de 1901 à "but non lucratif."
D’où l’importance d’un label sérieux ou d’une démarche responsable, non liés à des intérêts particuliers d’opérateurs privés, issu des connaissances de terrain et des pratiques qui s’y déroulent, en lien avec des scientifiques.
SEVVE constitue l’unique démarche répondant à ces principes de base.

4 – La finalisation et l’élaboration de deux grilles d’évaluation
En 2016, après la disparition de TER_RES, le retrait d’Alain Laurent, et avant le décès de Pascal LLuch, V.V.E a confié la finalisation de ce double système à Evan Lefevre, étudiant en Tourisme durable à la Haute école Robert Schuman de Belgique.
Celui-ci a effectué un travail exceptionnel, livrant au final les deux grilles d’évaluations.
Celle sur les hébergements comprend 66 critères ; la grille concernant les séjours, offres, ou territoires en contient 46.
Les deux permettent d’obtenir une note sur 100, donc au final un pourcentage : Par exemple 90 % d’écoresponsabilité dans la démarche d’untel et 75% pour une autre.
Ce double système fut baptisé et déposé à l’INPI sous le nom de SEVVE (Système d’Évaluation de l’Écotourisme porté par V.V.E).
Les deux Logos ont été réalisés par des étudiants de la formation « Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) », dont Julie Ambre en 2019.
5 – Des évaluations qui confirment la pertinence de la démarche
Voici les résultats concernant l’évaluation du programme d’écovolontariat « Étude des cétacés et de la biodiversité » proposé par Cybelle Planète (disparue), réalisée fin 2016.
En 2016 encore, le Centre l’Évasion au naturel, qui avait servi de structure test pour le label créé par la MITRA, fut évalué.
Il a obtenu une note proche de 100, ce qui donnait une référence.
Frédéric Desautel, le créateur de cette structure, n’en est plus le responsable, et s’est tourné vers un autre projet.
En 2018, ce sont des séjours de Katamkera en Corse, de Sardaigne en Liberté en Sardaigne, et les Gîtes Bon Air dans le Cantal qui furent soumis à une évaluation de terrain.
En 2019, dans le cadre des premiers Trophées du voyage durable, les organismes déclarés Lauréats ont également été évalués : Trekors, Languedoc Nature, et Itinéraires partagés, découvert en cette occasion.
Plus tard, un séjour sur les plantes d’Aluna Voyages en Auvergne, et depuis la création de l’ANEST, beaucoup d’autres en Savoie, Isère, Drôme, Alpes du Sud, Provence, dans les Cévennes, et récemment dans l’Aude, le Tarn, et le Tarn et Garonne.
La dynamique est lancée.
Les premières personnes habilitées à utiliser ce système ont signé un contrat avec l’ANEST, qui s’est vue confier son usage par V.V.E, leur permettant de l’utiliser.,
Pour le bien de tous, et de l’écotourisme en particulier.
SEVVE et « Destination d’excellence »
Le 5 janvier 2023, trois personnes issues du pôle tourisme durable de la DGE, au sein du Ministère de l’économie, ont eu un entretien avec Jean-Pierre Lamic qui venait de rédiger une analyse pour la Revue Espaces intitulée : Écotourisme, comment aider à sa mise en œuvre en France.
Elles eurent la primeur de l’étude, puisque celle-ci n’a été publiée qu’un mois plus tard.
L’un des deux sujets principaux de cet entretien, d’une durée approximative d’une heure et demie, était le Système SEVVE.
Nous venons d’apprendre la création d’un nouveau label intitulé Destination d’excellence.
Caractéristiques : il concerne l’offre touristique : hébergements, restauration, lieux de visites ou de loisirs, lieux d'information touristiques (offices de tourisme notamment), transports, propose des évaluations in-situ par des clients mystères, et ajoute un pilier « écoresponsable » au label Qualité tourisme, soit de nombreux points communs avec SEVVE.
Cependant, il ne prévoit pas d’évaluer des séjours ou offres en tout compris, que seul SEVVE permet toujours de nos jours, hormis les labels établis par les Parcs Nationaux et Régionaux.
(En 2011, V.V.E s’est rendue au Siège des Parcs Nationaux pour rencontrer Mme Laurence Chabanis, déjà à propos de SEVVE)…, soit avant la création d’Esprit Parc.
Il est donc fort probable que l’entretien du 5 janvier 2023 avait pour objet principal la prise d'information auprès des concepteurs de SEVVE dans le cadre de la création de ce nouveau label.
Par conséquent, une question se pose aujourd’hui.
V.V.E (depuis 17 ans) et l’ANEST (depuis près de 4 ans), qui n’ont reçu aucune aide de la part des pouvoirs publics, pas même une marque de considération, ni d’intérêt autre que 3 entretiens, (Dont un le 17 juin 2021 avec le même Ministère de l’économie), ont-elles vocation à transmettre leur savoir-faire, issu de 17 années de bénévolat à des fins non lucratives, sans contreparties, aux services de l’État ?
D'autant que suite à l'entretien du 5 janvier 2023, les personnes avec qui Jean-Pierre Lamic avait échangé ce jour-là, lui ont notifié "il n’y a pas de budget alloué pour financer la conception de sites Internet par des associations", donc pour celui que l'Association Nationale de l'Écotourisme et du Slow-Tourisme, créé début 2023.
Or, depuis trois ans, l'ANEST a pour objectif principal de donner au grand public l'accès aux offres d'écotourisme labellisées (15 labels reconnus), ou évaluées par SEVVE...
En Espagne, cette démarche est prise en charge et gérée par l'État depuis plus de 20 ans !
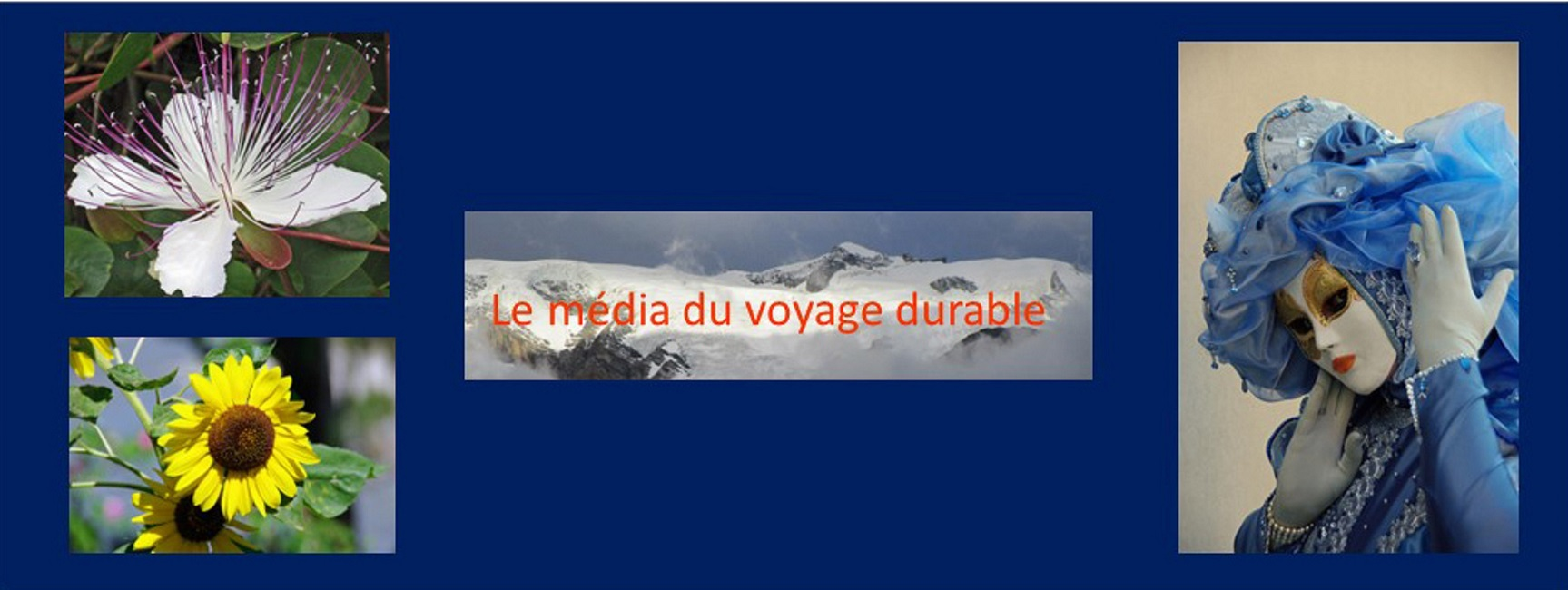

Ajouter un commentaire